Pour que la terre s'en souvienne
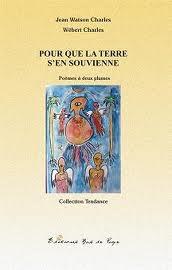
Pour que la terre s'en souvienne
« L’exil que nous fuyons... »*
C’est un siècle nouveau. Deux hommes avancent seuls dans les rues éventrées de Port-au-Prince et leurs voix semblent ricocher sur les briques éclatées, les conduites arrachées, sur la caillasse amoncelée, dans un brouhaha de fin du monde. C’est une marche à travers les reliefs du souvenir et de la séparation. Leurs inflexions alternent à nos oreilles comme une conversation douce-amère qui pourrait bercer les enfants qui ne comprennent pas encore le sens des mots. Ou les adultes déboussolés dans le vacarme des apparences de la Babel moderne. Ils se parlent sans vraiment se répondre car c’est en réalité à la terre et au ciel, aux éléments et, parfois, aux femmes qu’ils s’adressent.
‘Pour que la terre s’en souvienne’ et un journal de l’errance et de la convalescence après la destruction, un testament pour la mémoire, qu’on aimerait effectivement pour la terre, si seulement elle pouvait se souvenir, mais dont on se contentera qu’il reste marqué dans la mémoire des hommes.
Des souvenirs de l’avant jonchent le parcours « On s’aimait / Comme on va à la banque » ; « Nous n’irons plus à la mer / Par ce chemin ouvert au silence » ; « Je ne parviendrai jamais à t’écrire / Tous les murs plantés sur mes errances / Ni la mer dans mes mains ». Mais le poète n’est pas dupe : « Ici toute mémoire est un leurre ». Le refuge du souvenir est un mirage. Autant que les cœurs battent, autant que les ventres ressentent la faim et le désir, le monde est là, tout autour, en mouvement. Il n’attend pas et il faut (sur)vivre. L’homme ne peut compter que sur lui-même.
Après le traumatisme du séisme, l’abasourdissement et l’immense fatigue (« Désert dans mes yeux humides / Hormis mon sexe » ; « Mon cœur est un vieux moteur qui ne tourne plus »), la difficulté d’être et de parler (« Je ne parviendrai pas à te dire / Tout ce que le monde a connu ») viennent les questions ; celle par exemple du départ : « Partirai-je loin de mon île / La folie dans la gorge / Comme une langue coupée ». Mais la question est probablement oiseuse, car comme le note Wébert, l’exil, pour chacun des Haïtiens victimes du bouleversement, est déjà là, à l’intérieur. L’exil est devenu un état de fait, car si beaucoup des Haïtiens ont survécu, c’est le monde qu’ils connaissaient qui s’en est allé. Le départ, dans une étrange démonstration par l’absurde, pourrait-il y remédier ? Plus profondément encore les mots du poète révèlent que l’état d’exil fait partie de chaque être humain, de notre condition. Ne sommes-nous pas irrémédiablement enfermés dans le bagne doré, l’îlot de nos individualités, étrangers au monde et aux autres que nous dévisageons sans toujours les comprendre ? Ne sommes-nous pas abandonnés dès la naissance dans cet espace dur et dépourvu d’émotion, sans savoir et sans raison, à la merci de la moindre bourrasque, dans un exil quotidien ? Et les subterfuges dont nous usons, les illusions que nous construisons ne nous seront au final d’aucun secours : « L’exil que nous fuyons / Nous appartient / Plus que ces faux dieux / Qu’on invente et qui nous tuent »
Heureusement la beauté ravive les sensations et annonce l’espérance, d’abord par bribes : « Je rallume les fresques sur ton visage » ; « Chaque clarté est en moi / Comme une lueur à tes soifs / Chaque écho est un réveil à mes sens ». Puis en grands mouvements solaires : « Dites aux chants des oiseaux que nos mains reprennent la bannière ». Livré à lui-même, c’est en lui que l’homme puise les ressources du renouveau : « J’ai appris à hurler / dans les crinières du jour / A traverser les larmes ».
La poésie de Wébert et Jean Watson Charles s’instille en nous progressivement et aussi sûrement que l’eau engorge le sable à chaque marée sur Ibo beach. Par petites touches, dans des textes courts, matures voire sereins (souvent plus sereins chez Jean Watson : « Et j’attends tes jambes / Comme des fruits annoncés » que chez Wébert : « Quelle mère est-elle la mer / Mais quelle merde ! »), elle construit un palais de vent où il fait bon séjourner. Une poésie en fragments de bois flottés portés par l’écume et éparpillés sur le rivage, des parcelles d’un navire imaginaire à réassembler pour cingler vers d’autres sphères. Une poésie où la souffrance et le questionnement (« Comment écrire / Si les mots sont vides / Et les pages remplies / Si les marges marchent à reculons ») font parfois place à l’espoir. Où la douleur côtoie le sexe (« En moi / Il y a la mer à conquérir / pour trouver le bleu de ton pubis »). Où de la solitude surgit la quête (« Je cherche le chemin / Où les cœurs meurent par manque / D’amour et d’alcool ») et la trouvaille (« La mémoire utopique ment »). Il y a souvent une grande communion dans le style et le propos des auteurs, déjà frères par le nom, qui donne au recueil unité et force. Une poésie qui touche parfois au cosmique : « J’invente la mer / Et les ressacs / Mais le silence / Ne supporte plus / L’invagination des corps célestes ».
C’est un siècle nouveau, avec ses calamités et ses merveilles. C’est un siècle qui exige de nous et de nos dirigeants lucidité, responsabilité et générosité, au risque d’être balayés au rythme des ouragans, des sécheresses et des séismes. Il est loin le temps du combattant de la négritude dont Sartre dans son ‘Orphée Noir’ nous disait : « Il se veut miroir et phare à la fois ; le premier révolutionnaire sera l’annonciateur de l’âme noire, le héraut qui arrachera de soi la négritude pour la tendre au monde, à demi prophète, à demi partisan, bref un poète au sens précis du mot ‘vates’ ». Il est loin le temps où les poètes exhortaient leurs compatriotes à s’unir aux masses laborieuses du monde sous la bannière rouge « Debout les damnés de la terre / Debout les forçats de la faim » (Jacques Roumain). Et pourtant les mots de ces jeunes poètes haïtiens font échos à ceux de leurs illustres prédécesseurs, comme par exemple ceux de René Belance « J’ai mon âme plus grande que le spectacle de ma désolation. Je porte en mes yeux la nostalgie de mes déserts perdus. J’ai mes racines lointaines que perd la frondaison. » Ou ceux d’Anthony Phelps « Je porte en moi la densité de la nuit / Et les insectes font l’amour sur mes mains inutiles ». Et pourtant, ces deux hommes d’Haïti qui chantent la souffrance, le désenchantement mais aussi la joie et la jouissance en sont les dignes héritiers : « J’écris / Pour effacer nos années-lumière / Mais l’ivresse vient de partout / et me traverse » ; « Mille lieux m’habitent / Et les cœurs ont le nom des promesses ». Parce qu’au-delà des époques, des tempêtes et des soubresauts des sociétés et de leurs idéologies, voire de la couleur de peau, la condition humaine est une. Et pourtant, comme le dit encore Sartre : « Voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d’être vus ».
*Note sur le livre : "Pour que la terre s'en souvienne", de Jean Watson et Wébert Charles
Arnaud Delcorte,
Bruxelles, Le 11 Novembre 2011